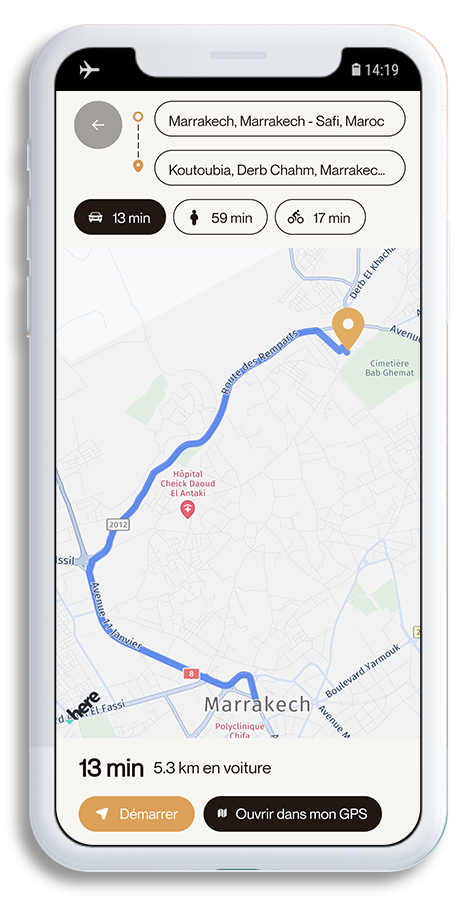Fès
La doyenne des villes impériales marocaines s’impose depuis sa fondation par Idriss Ier (786) comme le centre spirituel du pays. La ville ancienne doit sa splendeur à ce statut particulier autant qu’à la largesse des souverains. Aux Idrissides (première des sept dynasties marocaines) du IXe siècle succèdent au XIIIe, les Mérinides. Grands bâtisseurs, amoureux des arts et des sciences, ils vont développer une culture urbaine raffinée. Fès doit beaucoup à cette dynastie qui régnera jusqu’au XIVe siècle.
L’alliance entre pouvoir séculaire et pouvoir religieux se traduit par une répartition nette des quartiers : à l’est, Fès el-Bali où se rassemblent les monuments symboliques de son histoire ; à l’ouest, Fès el-Jedid, dédiée au palais royal et aux vastes esplanades d’apparat. Nombre de ses monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Dans Fès el-Bali, la mosquée Karaouiyine, de 859, abrite l’université musulmane de Fès, conservant ainsi sa fonction originelle. Ses élèves ou professeurs ont marqué l’histoire du monde arabe : Ibn Khaldoun, Averroès, Ibn el-Khatib… dans une proximité favorisant les échanges, les médersas (El-Attarine, El-Cherratine, Bou Inania), pôles culturels et religieux nantis d’une mosquée, d’un collège et d’une résidence universitaire ont été le berceau de confréries soufies et d’écoles spirituelles toujours influentes.
C’est dans ces édifices religieux que l’art arabo-andalou s’est exprimé jusqu’à la perfection : dans l’architecture (arcs et baies, minarets), la décoration (zelliges, stucs, calligraphies sur marbres, pierres et bois), le mobilier (bois sculptés, mihrab, balustres, etc.), dans l’art de l’enluminure, de la broderie, de la dinanderie ou de la peausserie.
À Fès, les artisans ont été fort nombreux, se regroupant par quartiers toujours lisibles dans la trame urbaine : quartier des Andalous et enclave juive (mellah), quartier des tanneries, souks… Les fondouks (El-Nejjarine, fondouk des Tétouanais) rappellent sa dimension commerciale.