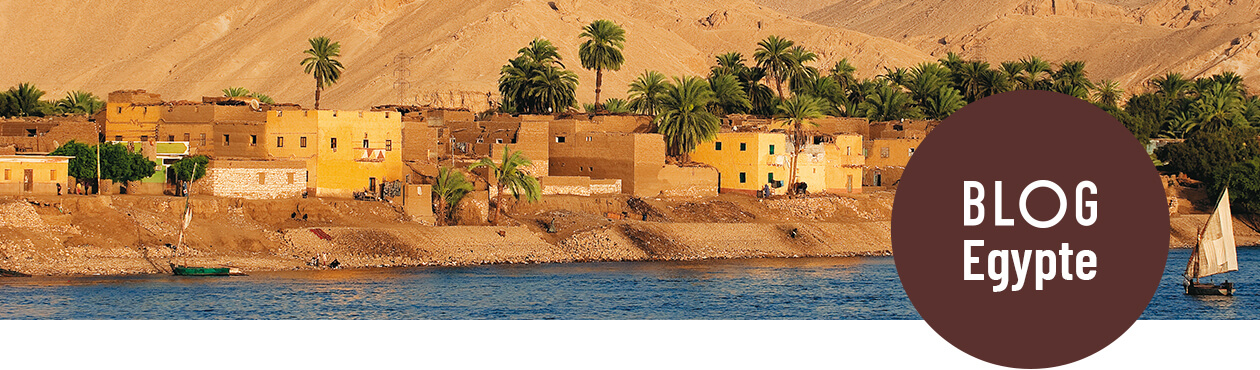
Les derniers articles
- La décoiffante histoire du fez égyptien
- Youssef Chahine, une histoire égyptienne
- L’Old Cataract, un palace sur le Nil
- Georges Henein et le surréalisme égyptien
- Bulles d'Égypte : la revue TokTok
- La décoiffante histoire du fez égyptien
- Youssef Chahine, une histoire égyptienne
- L’Old Cataract, un palace sur le Nil
- Georges Henein et le surréalisme égyptien
- Bulles d'Égypte : la revue TokTok
La décoiffante histoire du fez égyptien

20 févr. 2025
Introduit en Égypte au XIXe siècle, le tarbouche a été tour à tour marqueur de bonne société, vecteur d'unification d'un peuple, avant de tomber en désuétude et de devenir un symbole de l'envahisseur ottoman. Alors qu'il a aujourd'hui presque disparu – vous aurez peu de chances d'en rencontrer lors d'un voyage en Égypte, ce chapeau en feutre a laissé une empreinte singulière dans la société, entre nostalgie et rejet.
Si l’on ignore tout de l’origine du fez (Grèce antique ? Balkans ?), on sait en revanche que son arrivée en Égypte est le fait d’un homme : Mohamed Ali Pacha, gouverneur du pays pendant toute la première moitié du XIXe siècle. À l’époque, le couvre-chef en feutre rouge s’impose dans l’ensemble de l’Empire ottoman, devenant obligatoire pour les fonctionnaires, officiers militaires, policiers et religieux. C’est donc tout naturellement qu’il s’implante sur les rives du Nil, mais sous un autre nom : celui de tarbouche, combinaison de sar (tête) et de pouch (coiffure) en langue persane.
Une règle de bienséance masculine
L’apparition de ce « chapeau sans bord », à l’étrange forme de cône tronqué, représente une révolution dans la société égyptienne. Réservé dans un premier temps à l’élite, le tarbouche permet d'indiquer le statut et le niveau d'éducation de son propriétaire. Son port devient même un usage à respecter pour ne pas contrevenir aux bonnes mœurs. Un symbole de pouvoir, mais aussi de modernité, venu remplacer le turban traditionnel alors en vigueur.
| Pourquoi le fez est-il rouge ? La nuance rouge brillant caractéristique du fez (ou tarbouche) est obtenue par macération des baies de cornouiller mâle (cornus mas). |
Au fil du XIXe siècle, le port du chapeau se démocratise et s'étend à l’ensemble de la population masculine. Dans un pays aux fortes disparités sociales, il apparaît comme un élément d'unification, au point d'être coiffé par les officiers et fonctionnaires anglais, soucieux de s’intégrer à la population.
Un vestige de la monarchie
Après un siècle et demi d'implantation progressive et de popularité croissante, le tarbouche connaît un déclin aussi brutal que soudain. À son origine : Mustafa Kemal, qui accède au pouvoir en Turquie en 1925. Souhaitant éliminer radicalement les vestiges de l’Empire ottoman, celui que l’on surnomme Atatürk érige le fez en ennemi du progrès et en allégorie du fanatisme impérial. Face à cette interdiction, les hommes turcs se voient contraints de porter un chapeau européen.

En Égypte, il faut attendre la Révolution pour voir le couvre-chef tomber de son piédestal. En 1952, le général Gamal Abdel Nasser renverse le roi Farouk et s’en prend à son tour aux symboles de l'ancienne élite dirigeante. Parmi eux, le tarbouche, associé à la monarchie et à la domination britannique. En ordonnant sa disparition pure et simple, Nasser transforme le bonnet rouge en reliquat d’une époque révolue.
Un objet de folklore
De nos jours, les chances d’observer un homme coiffé d’un tarbouche lors d’un voyage en Égypte sont bien maigres. Seuls certains cheikhs et hauts dignitaires religieux s’attachent encore à cette tradition, accompagnés par les membres de la prestigieuse université d'Al-Azhar. Le tarbouche rouge cerclé de blanc porté par leurs diplômés est même l’un des symboles de cette noble institution islamique, considérée comme la plus importante au monde.
| Les secrets de fabrication du tarbouche Les tarbouches sont produits à partir de différentes nuances de feutre, un textile issu de l'ébouillantage et de la pression de poils de chèvre, mouton ou encore chameau. L'armature du chapeau est formée par un noyau de paille tressée, sur lequel le tissu est cuit à la vapeur. C'est l'amidon, pulvérisé ensuite, qui donne au chapeau son aspect rigide et droit. L'artisan pose une doublure en satin à l'intérieur, avant d'ajouter la touche finale : un pompon noir attaché par une courte queue rouge sur le dessus. |
À quelques pas de ses locaux, à l'est du Caire, trônent les derniers fabricants de tarbouche, une poignée d’artisans qui s’efforcent de perpétuer leur savoir-faire. Ironie de l’histoire : jusqu’au début du XXe siècle, la plupart des chapeaux n’étaient pas produits ici, mais importés... d’Autriche !
Au-delà de quelques personnes âgées empreintes de nostalgie, les tarbouches ne sont plus fabriqués que pour les employés des grands hôtels et les touristes qui souhaitent rapporter un souvenir de leur séjour. De marqueur social à objet de folklore, le tarbouche aura connu mille vies. Et pour cela, nous devons bien lui tirer notre chapeau.
